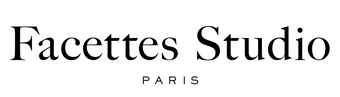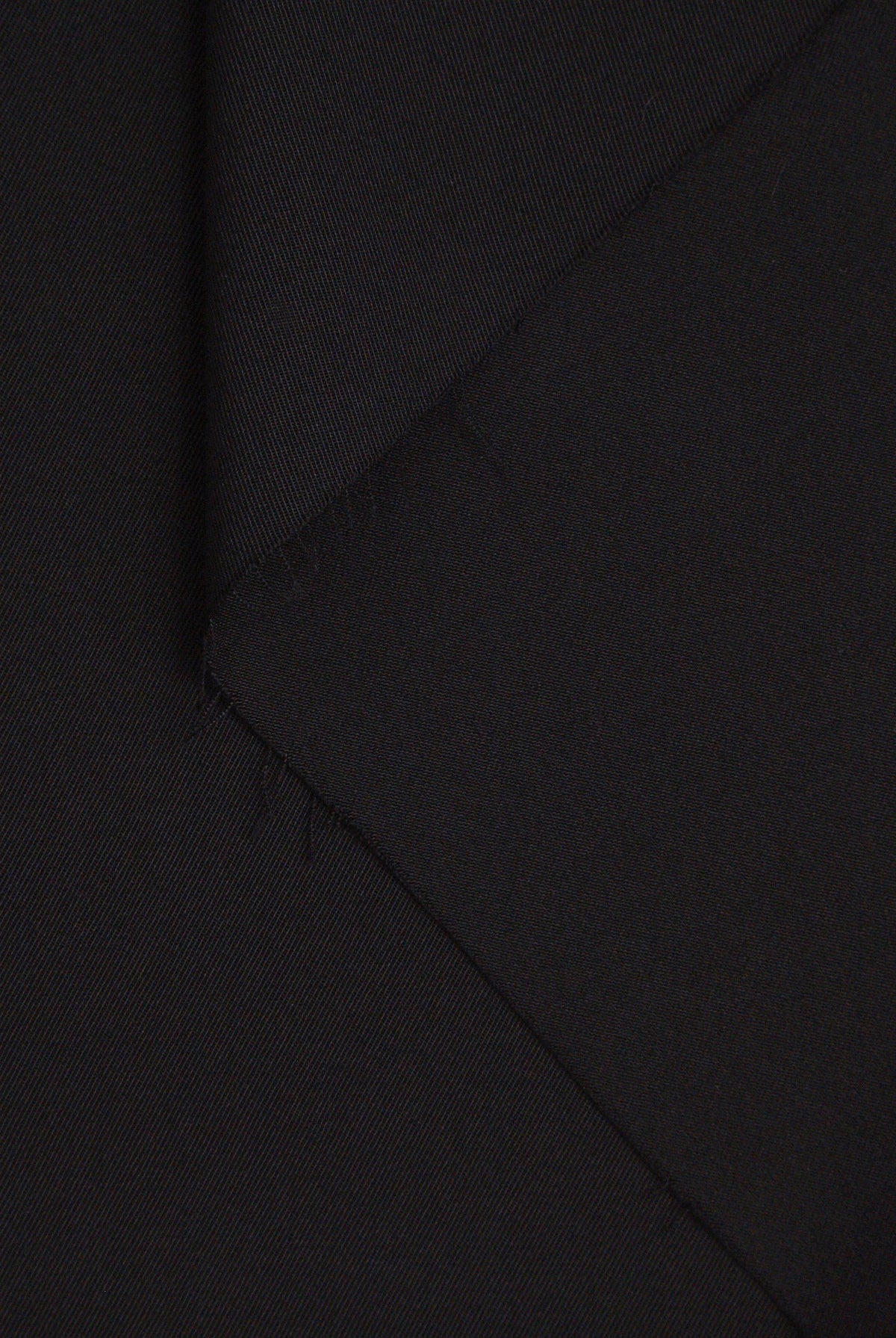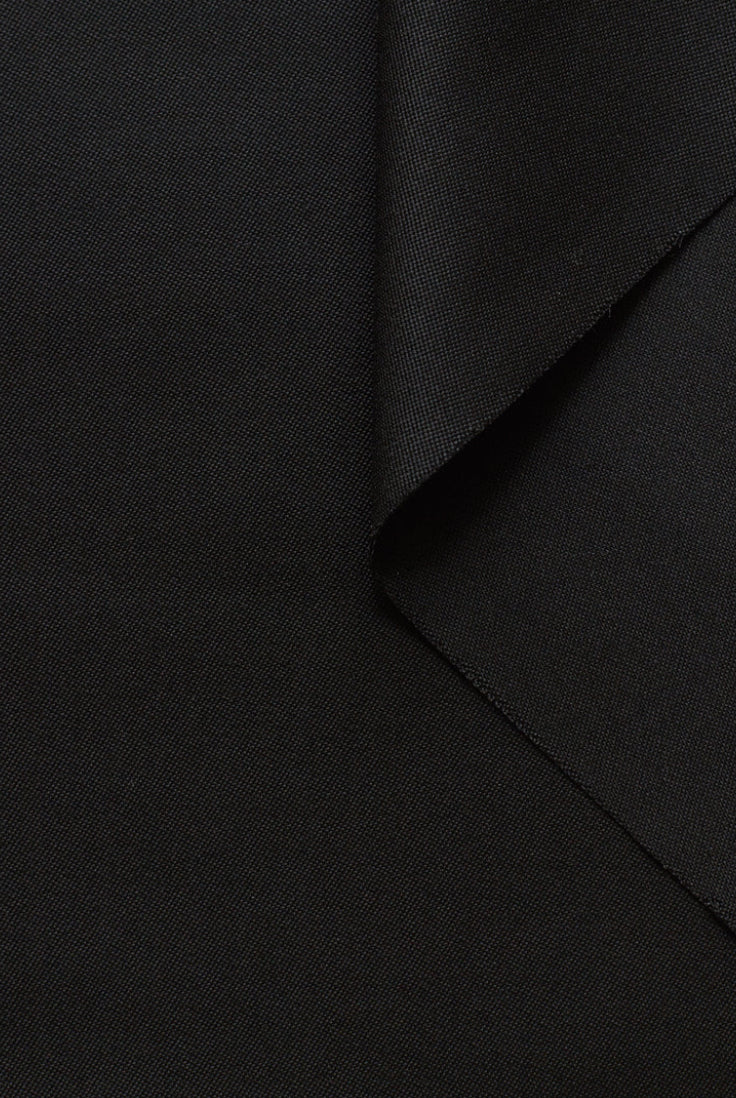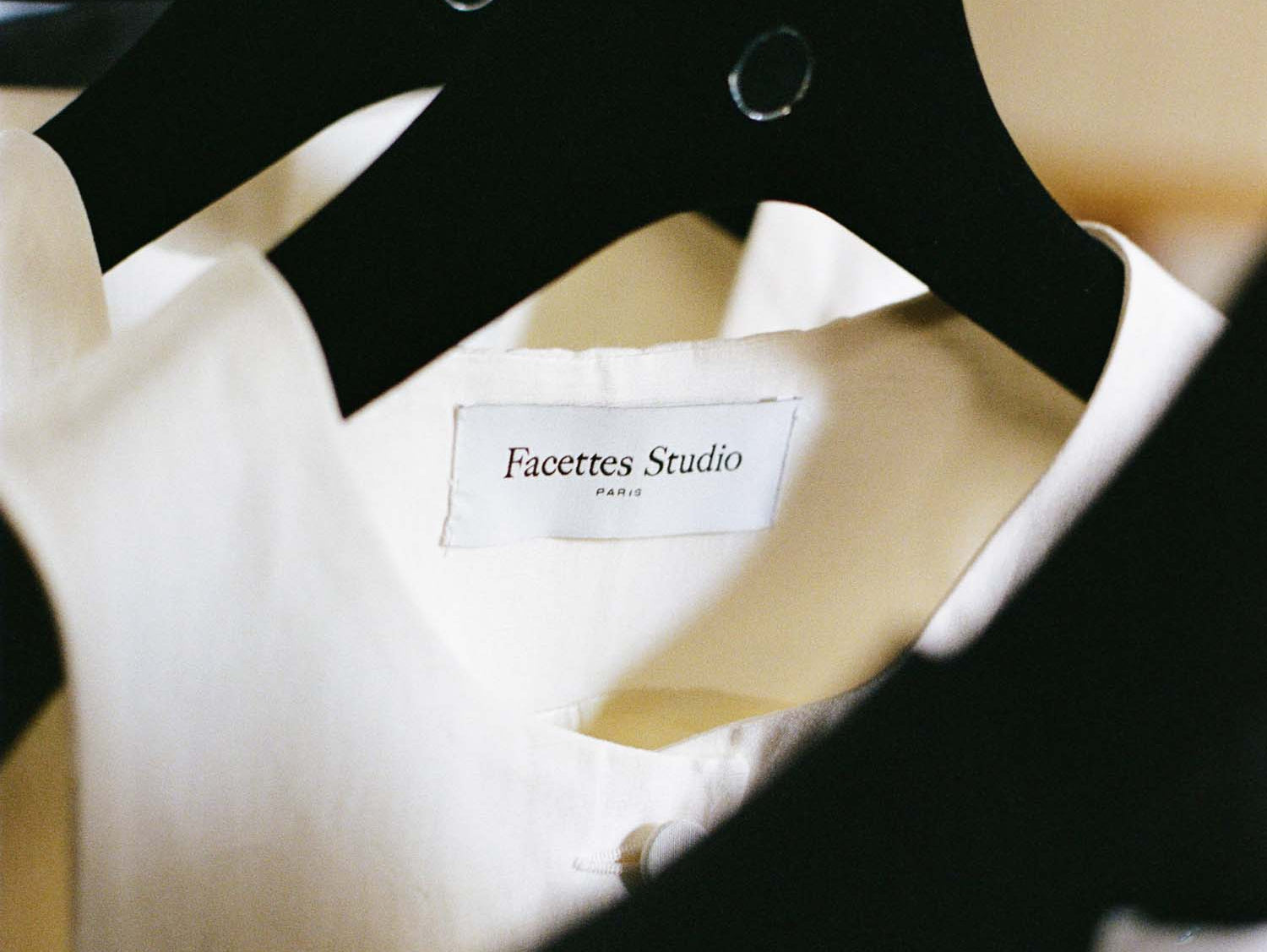L'Histoire du Gilet de Tailleur
Aujourd’hui perçu comme une pièce “à la mode”, le gilet est pourtant une pièce essentielle dans l’histoire du costume. Élément central du célèbre costume trois-pièces, il est longtemps resté réservé aux hommes avant d’être réinterprété et adopté par les femmes. Retour sur l’évolution d’un vêtement discret mais symbolique, de la cour du Roi-Soleil aux podiums contemporains.
1666 : Une pièce d’inspiration persane entre à la Cour d’Angleterre
C’est en 1666 que l’histoire du gilet européen commence véritablement. Charles II d’Angleterre, de retour sur le trône après une période de guerre civile, introduit dans la garde-robe masculine une pièce directement inspirée de la mode persane : un vêtement ajusté porté sous la veste, souvent long et orné.
Il s’agit alors de structurer la silhouette masculine, de poser les bases d’une tenue officielle que tous les hommes de la cour devront adopter. Charles II impose le port du “waistcoat”, ancêtre du gilet, aux côtés du manteau long et du pantalon bouffant. L’idée : fixer une norme, incarner la stabilité retrouvée de la monarchie.
XVIIIe siècle : Le gilet, pièce d’apparat
Au XVIIIe siècle, le gilet devient une pièce d’apparat. Il est souvent plus décoré que la veste elle-même : broderies, soies colorées, boutons précieux. Il exprime le rang social, le goût, le raffinement. Il est long, parfois jusqu’aux genoux, et joue un rôle central dans l’allure du costume masculin.
Mais à la fin du siècle, avec la Révolution française et la montée de la bourgeoisie, l’apparat s’efface au profit de la sobriété. Le gilet se raccourcit, devient plus fonctionnel, et suit le corps avec plus de discrétion. On entre dans l’ère de la retenue vestimentaire.
XIXe siècle : Le gilet au cœur du costume trois-pièces
C’est au XIXe siècle que le gilet trouve sa forme définitive : une pièce sans manches, à boutons, portée sous une veste croisée. Il devient un élément clé du costume trois-pièces, symbole du sérieux bourgeois, de la discipline et du statut professionnel.
À cette époque, chaque détail est codifié : le gilet est réalisé dans le même tissu que le pantalon et la veste pour les tenues les plus formelles, ou bien dans un tissu contrastant pour un style plus personnel. C’est aussi un vêtement pratique, qui permet de cacher les bretelles du pantalon, la chemise, ou une montre de poche attachée par une chaîne.
Le gilet de tailleur, une affaire d’hommes ?
Pendant des siècles, le gilet reste presque exclusivement masculin. Il appartient au domaine du tailleur, de l’uniforme, du pouvoir. Les femmes n’y ont pas encore accès, sauf à travers des figures marginales ou provocatrices.
Il faut attendre le début du XXe siècle pour voir les premières femmes s’approprier cette pièce. Gabrielle Chanel introduit un vestiaire féminin inspiré du confort masculin, mais le gilet reste en retrait. Il faudra Marlène Dietrich dans les années 1930 pour offrir au gilet un nouveau souffle, au féminin, dans des silhouettes androgyne et cinématographiques.


Années 1960-1980 : Le gilet de tailleur se féminise
À partir des années 1960, le tailleur-pantalon commence à entrer dans le vestiaire féminin. Le gilet suit lentement, souvent dans des ensembles trois-pièces pensés comme une version féminine du costume masculin. Yves Saint Laurent l’inclut dans certaines silhouettes, tout comme Jean-Paul Gaultier qui joue avec les genres.
Dans les années 1980, alors que les femmes investissent massivement le monde du travail, le gilet de tailleur s’impose comme une pièce forte du “power dressing". Porté ouvert ou cintré, seul ou en superposition, il symbolise une prise de pouvoir stylistique : ni une chemise ni une veste, mais un entre-deux audacieux.
Les années 2000 et aujourd’hui : Le gilet réinventé
Longtemps relégué au second plan, le gilet revient en force dans les années 2000, porté à même la peau, raccourci, souvent dépareillé. Les podiums s’en emparent à nouveau.
Aujourd’hui, il est devenu une pièce maîtresse de la garde-robe féminine : porté seul comme un top, sur une chemise oversize ou dans une silhouette trois-pièces repensée. Il incarne à la fois le retour à la sophistication et la liberté d’interprétation stylistique.


Le gilet chez Facettes Studio
Chez Facettes Studio, nous voyons dans le gilet de tailleur une pièce à part entière : élégante, affirmée, intemporelle. Pensé pour s’adapter à toutes les morphologies, notre gilet s’associe aussi bien à un pantalon tailleur coordonné qu’à un jean taille haute ou une jupe fluide.
Ni trop cintré, ni trop large, il est conçu pour mettre en valeur la silhouette sans la contraindre. Porté seul ou en superposition, il s’adapte aux saisons, aux envies, aux styles. Chaque détail, du bouton au revers, est pensé pour offrir une allure maîtrisée, mais jamais rigide.
Le gilet de tailleur : une pièce chargée d’histoire ancrée dans le présent
Du symbole monarchique au vêtement de pouvoir, le gilet du tailleur a traversé les siècles sans jamais perdre sa raison d’être : structurer, révéler, affirmer. Longtemps accessoire, il est aujourd’hui une pièce à part entière dans le vestiaire féminin, chargée d’histoire mais ancrée dans le présent.
Qu’il évoque l’élégance d’un dandy ou l’allure d’une femme libre, le gilet est plus que jamais une pièce d’expression personnelle.